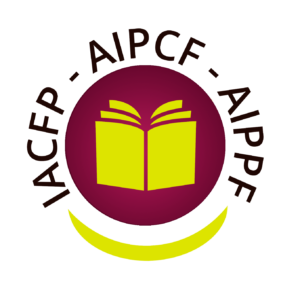REVIEW N° 32 | YEAR 2025 / 1
BOOK REVIEW
Jodi Picoult, Ma vie pour la tienne (2004)
Paris, Les presses de la Cité, 2007
Note de lecture par Margaux Bouteloup*
C’est l’histoire d’Anna, 13 ans, qui attaque ses parents en justice car elle ne veut plus être l’enfant-médicament de sa sœur aînée Kate.
C’est l’histoire de Kate, 16 ans, qui a besoin des dons d’organe de sa sœur Anna pour vivre.
C’est l’histoire de Sara (ancienne avocate) et de Brian (pompier), parents d’Anna, Kate et Jesse, pris dans un choix impossible : respecter la volonté d’Anna de ne plus être donneuse pour sa sœur, ou le lui imposer afin de sauver Kate.
Et c’est aussi l’histoire de Jesse, le frère aîné d’Anna et de Kate, qui, pour tenter d’exister dans cette famille, ne trouve d’autre chemin que celui de devenir délinquant et pyromane…
Jodi Picoult aborde, dans l’ouvrage Ma vie pour la tienne, le difficile sujet du “bébé-médicament” devenu grand et la question de l’autonomie décisionnelle (Bouteloup, 2021) de l’enfant dans sa famille. L’héroïne, Anna, a été conçue pour être génétiquement compatible avec sa sœur Kate, qui lutte depuis ses 3 ans contre une leucémie. Anna est donc, depuis sa naissance, la donneuse de Kate. Ainsi se construit le roman familial de ce groupe.
La question du don et de la dette est alors au cœur de cette histoire : qui est en dette de qui ? Y-a-t-il une dette supérieure à une autre, ou qui implique qu’on en accepte une autre ?
Anna a pour fonction de sauver sa sœur, fonction qui lui a été assignée avant sa naissance puisque c’est même la raison de son existence. Dans ce contexte, qui doit la vie à qui ? Est-ce Kate, l’enfant malade, qui doit la vie à sa sœur Anna, celle-ci la sauvant régulièrement grâce à ses multiples dons (sang, moelle…) ? Ou est-ce Anna, l’enfant génétiquement programmée, qui doit la vie à Kate, car, sans cette fonction thérapeutique, elle n’aurait pas été conçue ? Et dans ce cas, Anna est-elle dans une position de dette de vie (Bydlowski, 2020) vis-à-vis de ses parents qui l’ont conçue ? Ou bien est-ce eux qui sont en dette vis-à-vis de cette enfant qui porte la charge de leurs espoirs et la vie de leur aînée dans son propre corps ?
Cette dynamique de dons et de dettes qui, théoriquement, agit principalement de façon verticale (intergénérationnelle) se joue ici essentiellement sur un plan horizontal au sein de la fratrie ; l’ordre des générations semble s’inverser, puisque l’enfant, His Majesty the Baby selon l’expression freudienne, porte en elle la vie – et la survie – de tout le groupe familial.
Le frère, Jesse, n’est pas compatible avec Kate, et tout au long du roman nous côtoyons la solitude de cet aîné s’estimant ne rien valoir puisqu’il ne peut rien apporter à sa sœur Kate, et par ricochet ne s’estimant d’aucun soutien pour ses parents.
En mal de place dans sa famille, il adopte des conduites antisociales : il se drogue, vole, et ce fils de pompier devient même pyromane.
Et puis un jour, il y a la demande de trop : Kate est en phase terminale rénale et Sara, la mère, demande à Anna de donner un de ses reins à sa sœur pour la sauver, encore une fois.
Anna intente alors un procès à ses parents et demande le droit de disposer de son corps et de ne plus être donneuse pour Kate, même si cette liberté doit entraîner une forme de fratricide puisqu’elle a conscience que, sans ce don, Kate ne survivra pas.
Comment les parents peuvent-ils alors accepter, voire accompagner, l’émancipation légitime de leur fille cadette ? Quelle dynamique familiale vient ici être mise en branle par l’acte judiciaire ? Anna, qui est identifiée de façon explicite dans sa famille comme le régulateur (selon Brian, le père, « Anna est une constante dans notre famille »), cherche à s’affranchir de cette fonction et mandate pour sa défense un avocat dont elle réglera les honoraires en revendant un bijou qui lui a été offert suite à un de ses dons de moelle à sa sœur. Anna va devoir affronter ses parents en tant que partie adverse, ceux-là mêmes dont la mission première devrait être d’assurer cette même défense de leur enfant en toutes circonstances.
Mais quand protéger les intérêts de l’un des enfants semble contraire aux intérêts d’un autre enfant du foyer, n’y a-t-il pas un conflit de loyauté parentale insupportable ? Sara, la mère, peut-elle se sentir loyale envers chacune de ses deux filles en acceptant ou en refusant la demande d’Anna ?
D’autant que c’est Sara elle-même, ancienne avocate, qui représentera le couple en tant que partie adverse de leur fille cadette. La fonction d’avocat, garant de la loi, vient ici se mélanger à la fonction maternelle, garante du bien-être de l’enfant. Mais du bien-être de quel enfant parle-t-on ? Quelle fonction la loi vient-elle jouer dans cette famille ? Dans la loi française, il existe une forme d’ambiguïté autour de cette notion de bébé-médicament. Le Comité consultatif national d’éthique a d’ailleurs proposé, en 2002, de remplacer ce terme par « bébé du double espoir », avec l’idée qu’il est acceptable d’un point de vue éthique qu’un « enfant désiré représente un espoir de guérison pour son aîné si cet objectif est second ». Mais qu’en est-il lorsque cet enfant est né ? Comment accompagner Sara et Brian pour qu’ils puissent « faire des choix éclairés en matière de santé pour deux de leurs enfants dont les intérêts sont opposés sur le plan médical » (p. 548) tel que l’évoque le juge ?
Dans cette famille en souffrance, la parole circule difficilement : « Nous semblons avoir la douloureuse habitude de ne pas dire ce qu’il faut et de dire ce que nous ne pensons pas » (p. 130).
Ainsi, les pulsions fratricides, alors qu’elles sont régulièrement réactualisées et mises sur le devant de la scène en raison de la réalité médicale de Kate, semblent ne pas pouvoir être contenues, mises au travail au sein du groupe familial. Anna rapporte, par exemple, qu’à l’âge de 3 ans, elle a voulu étouffer sa sœur, illustrant comment les gestes remplacent les paroles. Son père l’arrête, la recouche et lui dit : « On va faire comme s’il ne s’était jamais rien passé » : la pulsion fratricide passée à l’acte est ainsi évacuée. Le frère aîné illustre également cette dynamique : Jesse adopte de nombreux comportements à risque allant jusqu’à provoquer volontairement des incendies qui seront éteints par son père pompier. Quelle fonction paternelle est ici convoquée ? Quel feu y a-t-il à contenir, à éteindre à l’intérieur de ce foyer ?
Alors que nous pensons, tout au long du roman, assister à l’émancipation d’Anna qui tente d’échapper à la fonction qui lui a été assignée, soutenue par le père qui parvient à jouer son rôle de tiers et qui se dit prêt à accepter la décision d’Anna – et donc à perdre Kate –, nous découvrons à la fin du livre que les enjeux de séparation-individuation qui semblaient émerger chez Anna sont beaucoup plus complexes.
Une fois de plus, les actes viennent prendre la place des paroles… Nous découvrons que c’est Kate qui a demandé à sa sœur de ne plus être sa donneuse (et de refuser le don de rein) ! De nouveau, Anna va être la messagère et la régulatrice du groupe familial et porter le droit de sa sœur à ne plus se soigner et à mourir. Kate est fatiguée des traitements, lasse de cette vie de souffrance, d’espoirs et de rechutes, et le don de rein par sa sœur pour la maintenir en vie s’apparente pour elle à un maintien dans une cage capitonnée dont seule Anna peut ouvrir la porte. Anna apparaît alors comme étant à la fois la sauveuse et le bourreau de Kate.
Dans cette famille, non seulement le libre choix d’Anna d’être donneuse n’est pas interrogé, mais celui de Kate de ne plus se soigner n’est pas pensable.
Sara, la mère, ne parvient pas à s’imaginer que Kate ne veut plus vivre, d’autant plus après toutes ces années de combat mené ensemble.
C’est alors encore Anna qui est désignée pour porter le poids de l’issue, dans cette famille engluée dans la souffrance où la frontière entre amour et individuation ne peut être parlée.
Anna gagne son procès : elle est émancipée de ses parents pour toutes les décisions médicales qui la concernent. À la sortie du tribunal, elle veut se rendre à l’hôpital pour l’annoncer à Kate, mais elle est victime d’un accident de voiture mortel… Elle devient ainsi donneuse d’organe post-mortem pour Kate qui survivra à l’intervention et vivra de nombreuses années.
Alors que le roman familial primaire (celui d’avant la maladie de Kate) se réalise – être à quatre (Jesse, Kate, et les deux parents, tous en bonne santé) –, la mort d’Anna vient détruire le roman familial secondaire à cinq qui s’est construit ces 13 dernières années, et désorganise profondément la famille avec l’apparition de problématiques addictives chez le père (alcoolisme) et dépressives chez la mère.
Les parents se retrouvent confrontés à un deuil non anticipé, celui de l’enfant qui n’était pas destiné à mourir, Anna, leur petite fille aimée et en bonne santé.
Car, au-delà de l’angoisse familiale de perdre Kate – angoisse qui prend tout l’espace –, l’amour du père et de la mère pour chacun de leurs enfants est patent. Leur fille Anna est certes venue au monde avec la mission de sauver sa sœur, mais elle n’en est pas moins aimée en tant qu’enfant du foyer.
Tout au long du roman, le fonctionnement de ce groupe familial interroge sur le type d’appareillage qui a pu s’établir en son sein.
Le mode isomorphique semble, pendant plusieurs années, permettre à ce foyer de maintenir une unité familiale malgré les épreuves récurrentes liées à la maladie de Kate. Lorsque le corps de Kate est malade, le corps d’Anna est là pour y suppléer.
Jesse (le frère sans fonction attitrée), ne parvenant pas à trouver sa place dans ce fonctionnement isomorphique, sort du système, part vivre dans le garage et vient attaquer comme il le peut le groupe familial afin de se garantir un rôle.
Dans un second temps, lorsque la souffrance du corps de Kate, à son acmé, envahit la totalité de l’espace groupal, alors s’installe un mode d’appareillage en tourbillon (Kaës, 2005), résultat de « l’instabilité chaotique de l’accordage des psychés » (p. 22) mais aussi de l’accordage des corps.
Cette impossibilité d’accordage des corps s’accompagne d’une incapacité à parler et donc à symboliser leur expérience en famille. Il n’y a plus de transformation possible de l’espace psychique groupal qui arrive à sa fin en l’état. Le désaccordage de chacun des membres du groupe génère donc un traitement paradoxal de l’appareillage : « les sujets établissent un accordage sur le mode du non-accordage, un lien non-lien sans cesse attaqué et déplacé, à la manière d’un tourbillon » (ibid.).
La loi vient alors ici essayer de réguler ce groupe en souffrance, et mettre fin à cette modalité de fonctionnement. La décision du juge doit permettre à chacun de retrouver sa juste place au sein du groupe familial : « le sujet découvre qu’il ne peut pas occuper toutes les places, successivement ou simultanément, mais seulement la sienne » (ibid., p. 23).
Mais comment chacun aurait-il pu, dans cette famille, trouver sa place après la mort d’Anna, l’enfant assignée à la vie : la sienne, celle de sa sœur, et celle du groupe ?
Bibliographie
Bouteloup, M. (2021). Fiche 10. Dépendance et Fin de Vie. In P. Menecier (sous la dir.), Les dépendances au fil de la vie. 11 fiches pour comprendre (pp. 125-135). Paris: In Press.
https://doi-org.scd1.univ-fcomte.fr/10.3917/pres.menec.2021.01.0126.
Bydlowski, M. 2020. Devenir mère. Paris: Odile Jacob.
Kaës, R. (2005). Groupes internes et groupalité psychique : genèse et enjeux d’un concept. Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 45(2), 9-30 ; https://doi.org/10.3917/rppg.045.0009.
* Psychologue clinicienne, Maître de conférences en Psychologie clinique, Laboratoire de Psychologie EA3188, Université de Franche-Comté ; collaboratrice scientifique, Université de Genève. margaux.bouteloup@univ-fcomte.fr