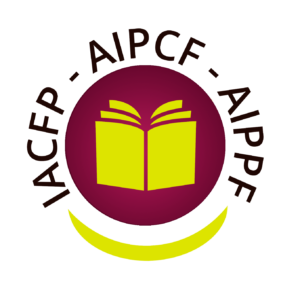REVIEW N° 32 | YEAR 2025 / 1
BOOK REVIEW
Monique Dupré la Tour, À l’écoute du couple
Lyon, Éditions Chronique sociale, 2025
Note de lecture par Ellen Jadeau*
De nombreux ouvrages et revues traitent de la clinique du couple et nous permettent un repérage théorique considérable. Nous connaissons en revanche moins bien les différentes approches du couple, les cadres conceptuels pour les accueillir et les manières de travailler. Dans À l’écoute du couple, Monique Dupré la Tour part de son expérience professionnelle et revient, avec beaucoup de recul, sur la construction de l’écoute du couple, son cheminement et ses achoppements. Et, chose rare, elle permet au lecteur de relier les approches du couple aux institutions de formation et associations de soin.
Cela aurait pu s’appeler : Peut-on écouter les couples sans puiser dans l’histoire des origines et des filiations des théoriciens et cliniciens de couple? ou bien Peut-on écouter les couples sans se confondre avec eux ou perdre soi-même une suffisante distance par rapport à sa clinique, son vécu?, tant la force de l’écoute de Monique Dupré La Tour se situe dans sa capacité à soutenir le questionnement, l’étonnement et le doute. Ce ne sont en effet pas les réponses qui font l’intérêt de son ouvrage mais les questions et la façon dont elle les fait s’articuler et résonner entre elles. L’auteure met en tension la démarche clinique du sujet face à son histoire avec la démarche de l’écoutant, du professionnel, du lecteur, de l’écrivain, du superviseur comme des démarches subjectivantes. Ne sommes-nous pas toujours en quête d’origines, personnellement et également professionnellement? Le couple est en effet un espace de reprise et d’élaboration des processus d’individuation, l’auteur appelle le couple une matrice de subjectivité.
Cet ouvrage propose d’écouter les différents niveaux d’organisation psychique et affective de l’objet-couple et d’ajuster son écoute, à des niveaux plus ou moins profonds avec des supports et des outils adaptés, allant de l’écoute de l’intersubjectif en conseil conjugal à l’écoute psychanalytique du lien groupal, en passant par les entretiens individuels, les thérapies individuelles centrées sur le conjugal, l’accueil spécifique des conseillers conjugaux familiaux, les thérapies conjointes, les thérapies de crise, la co-thérapie, l’intercommunication et la métacommunication. Ces vignettes et récits cliniques permettent d’éclairer les approches méthodologiques.
La législation, tout en évoluant avec la dynamique sociale, fait évoluer les représentations sociales en faisant passer ce qui était interdit à ce qui devient permis (contraception, avortement), en mettant les acteurs dans une conflictualité psychique interne (couples, hommes et femmes, professionnels, accompagnants). Deux chapitres sont consacrés au travail spécifique des conseillers conjugaux et à celui des conseillers conjugaux et familiaux. Ils permettent de différencier les objectifs et projets de chacun, ainsi que la place de la législation concernant la contraception et l’IVG. L’auteure prend appui sur l’histoire lyonnaise de différentes institutions qu’elle resitue, centrées en fonction de leurs compétences et leurs modalités d’écoute, car les missions de chacune influencent la manière d’accueillir et d’accompagner la demande individuelle et la demande du couple. À l’heure actuelle où le droit à l’IVG vient d’entrer dans la constitution dans notre pays mais est interrogé dans d’autres, il est intéressant de revenir sur son histoire et sa place en France.
Cette conflictualité psychique est inhérente à la problématique sexuelle. Elle traverse la rencontre – dans l’entretien avant IVG, par exemple – ainsi que la vie institutionnelle des associations: intime, permis et interdit, désir et réalisation, plaisir et satisfaction, identité, culpabilité, perte mais aussi émotion, vécus, élaboration et sens.
Le travail d’aide et d’accompagnement au niveau conscient et préconscient a évolué vers un travail de soin puis vers une approche thérapeutique qui se définit et se délimite notamment autour de l’analyse de la demande – manifeste, latente – et l’accueil de la crise, spécifique avec une notion d’urgence. L’auteure explicite cette évolution et définit chaque cadre et son objet spécifique allant de la décharge, du soutien, de réassurance, de dédramatisation, aux interventions à partir des troubles de communication, jusqu’au cadre très spécifique de l’utilisation du transfert dans un but analytique puis dans une approche groupale du lien lorsque le niveau narcissique est interpellé.
Un chapitre entier est consacré à la consultation conjugale à l’AFCCC (Association française des centres de consultations conjugales) du fait de sa place historique et centrale au cœur des changements sociaux et des changements dans les modalités, les attentes et les représentations de couple. L’auteure établit les parallèles nécessaires avec les fonctionnements de couple lorsqu’il s’agit d’institutions s’occupant d’eux et de décrire les interférences, influences et évolutions du conseil conjugal. Elle intègre alors les faits sociétaux et historiques pour comprendre l’évolution des formations des recherches méthodologiques qui ont traversé la profession. C’est en effet peu à peu le groupe couple (grouple) qui devient le patient et non l’individu et le couple. Parlons-nous encore d’aide ou de soin, de communication ou de compréhension, ou même d’analyse? L’intérêt de la psychanalyse pour le couple va considérablement transformer ses apports théoriques et méthodologiques nécessitant un travail personnel analytique et une formation spécifique à l’écoute psychanalytique du lien groupal. L’auteure reprend pas à pas le bouleversement que la profession a subi.
De manière globale, la lecture de l’ouvrage fait (re)visiter le sens des crises, les points de fixation, le questionnement de la distance dans le lien, des projections de soi dans l’autre. Ce sont les enjeux de la recherche d’un espace d’écoute, d’élaboration de la crise et d’approfondissement de soi, de questionnement de l’organisation psychique et de la remise en route de la symbolisation et de la subjectivation.
Le processus thérapeutique fait évoluer l’organisation psychique des sujets mais également la structure du couple: le processus de différenciation psychique, l’élaboration des fonctionnements paradoxaux des liens, la maturation des processus primaires en secondaires, la régression, l’acceptation des traumatismes et des pertes, l’advenue de l’ambivalence et la créativité. Ce livre offre un repérage dans ces étapes permettant au lecteur de confronter la terminologie issue des conceptualisations, époques et courants différents sans faire l’économie de l’analyse du positionnement thérapeutique (place du thérapeute dans la dyade retrouvée en séance).
Chaque cadre, contrat, dispositif et positionnement clinique est analysé en termes de sens, d’ouverture et de triangulation, nécessaire à l’évolution des liens et à la reconnaissance de l’altérité dans le rapport à l’autre. Des exposés concrets illustrent cette problématique couple-individu permettant en séance à chacun des partenaires, à partir de la circularité des sentiments qui les lient, un travail sur la différenciation psychique qui ouvre sur la capacité à exister devant l’autre et la reconstruction du couple tiercéisé.
Triangulation encore dans la supervision et l’écriture. Un chapitre est consacré au besoin des thérapeutes, plongés avec les couples dans les fonctionnements psychiques de type narcissique. Ceux-ci vont régresser vers ces niveaux archaïques puis réémerger, se décoller de nouveau et rester vivants psychiquement. Le processus de tiercéisation est fondamental pour la capacité à penser et à enrayer la répétition mortifère, et l’auteure met ses propres expériences au travail. Elle souligne à quel point il est important de s’approprier sa pratique et d’écrire sa pensée propre, il s’agit là encore d’un processus d’individuation sur lequel elle met un accent fort.
Le couple est un lien important pour le travail de la différence, notamment celle des sexes et ce, particulièrement à travers la rencontre dans la sexualité. L’ouvrage traite évidemment également de la place, la fonction, la présence ou non des relations sexuelles. La sexualité, génitale et prégénitale, interagit avec les autres données du couple. Dans les relations sexuelles, niveau narcissique et niveau objectal sont interpénétrés. De nombreux exemples viennent éclairer la signification des avatars de la sexualité jusqu’à l’accession à la sexualité de jouissance, selon l’expression de J. Schaeffer (2013), pour la cocréation du masculin et du féminin. Suivant ce fil de la sexualité comme celui de la conflictualité dans le lien, l’auteure met au travail l’exogamie et l’endogamie dans le couple, l’hétérosexualité et l’homosexualité: tout autant d’aspects dans lesquels les partenaires du couple se retrouvent pour se chercher!
Si chacun dans le couple peut lutter pour sortir de la confusion, qu’en est-il des conseillers et des thérapeutes? À quoi servent les recherches méthodologiques et les formations des professionnels? Quand un travail personnel analytique est-il indispensable pour écouter le couple? Telles sont les questions que cet ouvrage approfondit. La position transférentielle est centrale dans l’écoute du couple. Quelle place occupons-nous devant le couple? Le transfert se déploie en priorité de manière objectale dans une thérapie individuelle, il en est tout autre lorsque nous sommes devant un couple en crise et en proie à la violence. L’auteure fait appel à l’écoute de l’utilisation de l’objet dans le travail avec les couples et donne une large place à la tendance à la destructivité (Winnicott, Roussillon) et aux angoisses primitives. Les illustrations cliniques montrent son plein engagement, notamment dans les vécus contre-transférentiels et les solutions de dégagement trouvées.
D’autres situations cliniques viennent éclairer des aspects du couple, comme la place et le sens de la violence intraconjugale, des difficultés sexuelles, de l’addiction, des rivalités, des somatisations, de l’adolescence des enfants, de la séparation d’avec les lignées familiales. Elles proposent ainsi également de resituer les concepts fondamentaux de l’écoute du couple.
L’auteure montre comment on peut s’appuyer sur la répétition scénique en séance des modes relationnels qui renvoient le plus souvent aux fondements du couple. Elle souligne que leur accueil, difficile mais indispensable en thérapie, ainsi que leur mise en sens progressive en référence au contexte transféro-contretransférentiel permettent la remobilisation et l’acceptation des processus du couple. Cet accueil des afflux d’affects et leur élaboration vont permettre un passage de la scène au travail psychique du couple et, ainsi, le passage d’un mode de structuration à un autre, plus favorable, plus vivant psychiquement. Pour ce qui est des liaisons extraconjugales qui interrogent les thérapeutes, les écoutants et les conseillers, l’auteure engage une réflexion sur la fonction de ce tiers concret dans le lien de couple. Les vignettes cliniques montrent l’organisation de la bisexualité, active et passive, du couple, sa remise en question dans la crise conjugale, les questions d’identité sexuelle et les étapes maturatives de ces crises entre «un espace impossible entre soi et l’autre» et un «espace potentiel » de nouveau possible, modifiant la structure du couple.
Monique Dupré la Tour réussit à décondenser et clarifier la clinique du couple, par essence une clinique de la confusion, chaque partenaire logeant chez l’autre une part inconnue de lui-même. Elle montre à quel point la clinique du couple est un riche réservoir de recherches identitaires : ce qu’elle appelle la matrice de subjectivité. Le but constamment poursuivi dans cet ouvrage est la quête de sens, à partir des crises, demandes, oppositions et différences du couple, pour le renforcement de l’organisation identitaire de chacun des partenaires.
* psychologue clinicienne psychanalyste, thérapeute du groupe, du couple et de la famille ; ellen.jadeau@free.fr