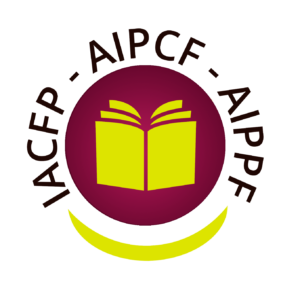REVIEW N° 32 | YEAR 2025 / 1
Summary
Eruptions of involuntary interruptions of life: Traumatic resurgences, serious somatic illness, and perinatal resonances
The diagnosis of a lethal illness (“event-illness”) can reactivate unresolved past traumas, making it important to examine the consequences of these past events and their impacts on the psychosomatic economy of the individual. In Sylvie’s case, the announcement of a diagnosis of cancer (a pulmonary illness that was metastatic from the start) awakens several unresolved traumas, the most painful of which is the death of her first child at the age of seven months, as well as the death of her mother under very painful circumstances. The intensity of these reactivations leads her to become aggressive with her loved ones (husband and children). Thus, it appears that events related to perinatality isolate Sylvie in her experience of illness: it is not the quality of the bonds between the members of the couple and/or the family that proves problematic, but rather the patient’s history that prevents her from accepting the support offered by her loved ones. Family history resonates with the emerging bodily manifestations, reactivating traumatic experiences of loss and mourning that raise questions in relation to a family fate neurosis, in this instance in an individual.
Keywords: Cancer, trauma, death, mourning, perinatality.
Résumé
Irruptions d’interruptions involontaires de vie: résurgences traumatiques, maladie somatique grave et résonances périnatales
L’annonce de la maladie létale (“événement-maladie”) peut réactiver des traumatismes anciens non élaborés: il apparaît ainsi intéressant d’interroger les conséquences de ces événements anciens et leurs impacts sur l’économie psychosomatique du sujet. Chez Sylvie, l’annonce du cancer (maladie pulmonaire d’emblée métastatique) réveille plusieurs traumas non élaborés, dont le plus douloureux est la mort de son premier enfant, à l’âge de sept mois, ainsi que celui du décès de sa mère, dans des circonstances très douloureuses. La violence de ces réactivations l’amène à devenir agressive avec ses proches (mari et enfants). De la sorte, il apparaît que des événements liés à la périnatalité isolent Sylvie dans son vécu de la maladie: ce n’est alors plus la qualité des liens entre les membres du couple et/ou de la famille qui se révèle problématique, mais bien l’histoire de la patiente qui l’empêche de se saisir du soutien offert par ses proches. L’histoire familiale entre en résonance avec les manifestations corporelles émergentes, réactivant des vécus traumatiques de pertes et de deuils questionnant une névrose de destinée familiale ici individuelle.
Mots-clés: Cancer, traumatisme, mort, deuil, périnatalité.
Resumen
Irrupciones de interrupciones involuntarias de la vida: resurgimientos traumáticos, enfermedad somática grave y resonancias perinatales
El anuncio de una enfermedad letal (“enfermedad-acontecimiento”) puede reactivar antiguos traumas no elaborados. Por ello, es interesante examinar las consecuencias de estos antiguos acontecimientos y su impacto en la economía psicosomática del sujeto. En el caso de Sylvie, la noticia de que tenía cáncer (una enfermedad pulmonar que se metastatizó inmediatamente) reactivó una serie de traumas no elaborados, de los cuales los más dolorosos fueron la muerte de su primer hijo, de siete meses, y la muerte de su madre, en circunstancias muy dolorosas. La violencia de estas reactivaciones la llevó a volverse agresiva con sus allegados (marido e hijos). De este modo, parece que los acontecimientos relacionados con el periodo perinatal aíslan a Sylvie en su experiencia de la enfermedad: ya no es la calidad de la relación entre los miembros de la pareja y/o la familia lo que resulta problemático, sino la propia historia de la paciente, que le impide aprovechar el apoyo que le ofrecen sus allegados. La historia familiar resuena con las manifestaciones corporales emergentes, reactivando experiencias traumáticas de pérdida y duelo, poniendo en cuestión una neurosis de destino familiar o individual.
Palabras clave: Cáncer, trauma, muerte, duelo, cuidados perinatales.
ARTICLE
Irruptions d’interruptions involontaires de vie: résurgences traumatiques, maladie somatique grave et résonances périnatales
Delphine Peyrat-Apicella*, Romuald Jean-Dit-Pannel**
[Reçu: 5 mai 2025 – Accepté: 23 juin 2025]
DOI: https://doi.org/10.69093/AIPCF.2025.32.01
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
Introduction
L’annonce de la maladie somatique grave, ici le cancer, revêt un caractère traumatique à plusieurs titres: risque létal inhérent aux représentations de la maladie ou à sa gravité (dimension réelle et/ou fantasmatique), impact de traitements éprouvants et souvent mutilants, vécus extrêmes désubjectivants induits par l’omniprésence du monde médical et ses effets (Peyrat-Apicella, 2022). Ainsi, la confrontation au réel de la mort se révèle traumatique pour le patient, mais également pour ses proches: l’existence du sujet est remise en question, ainsi que sa vie personnelle, professionnelle, sociale, mais également ses rapports affectifs et son mode de vie (Marin, 2014). Parfois, l’annonce de la maladie ou son évolution réactivent des traumatismes anciens non élaborés, rendant impossible la mise en sens de l’“événement-maladie” (Peyrat-Apicella, 2018). La maladie prend alors valeur de tsunami dans la vie du patient et de ses proches, impactant les liens et ses organisateurs, nécessitant parfois un réaménagement de l’ensemble des liens familiaux et une modification des places et des enjeux de ceux qui sont appelés désormais des “aidants familiaux”, qu’ils souhaitent endosser ce rôle… ou pas (Bonnet et al., 2020).
Nous proposons ici de développer le cas clinique de Sylvie, pour qui l’entrée dans la maladie somatique grave va convoquer des résurgences traumatiques particulières, celles d’irruptions d’interruptions involontaires de vie, notamment en lien à des périodes périnatales. En effet, chez Sylvie, l’annonce d’un cancer (une atteinte pulmonaire d’emblée métastatique) réactive plusieurs traumatismes non élaborés, dont le plus brûlant est la mort de son premier enfant, un petit garçon âgé de 7 mois, quarante ans plus tôt. Cette annonce ravive également le choc relatif au décès de sa mère, survenu quelques mois avant l’annonce de la maladie. La violence de ces réactivations de pertes d’objets, directement en lien avec une menace de mort réelle, amène Sylvie à devenir agressive avec ses proches: son mari essentiellement, mais également ses enfants et certains amis. Dans un premier temps, les résurgences traumatiques isolent la patiente dans son vécu de la maladie: ce n’est alors pas la qualité de présence du membre du couple (son second mari, depuis une trentaine d’années) qui est problématique, mais bien l’histoire de la patiente qui l’empêche de saisir que son conjoint est soutenant. Elle dit se rendre compte à quel point celui-ci est protecteur. Elle l’a entendu dire récemment “on” est malade et a trouvé cela touchant. Il lui a évoqué son impuissance quant au fait de passer son temps à aider les autres, alors qu’il pense ne pas pouvoir l’aider, elle. Pour autant, il n’a rien dit de la maladie de sa femme sur son lieu de travail (il est pompier).
Finalement, Sylvie tient son mari à distance de sa maladie et surtout de son vécu douloureux, du fait de résurgences traumatiques inélaborables, dont un événement périnatal en lien pour elle avec le diagnostic de pathologie létale. Monsieur n’étant pas le père de cet enfant, il n’a pas subi lui-même ce traumatisme et n’en a reçu que quelques échos. Au cours d’un travail psychothérapeutique que Sylvie a elle-même initié, l’évocation de ces traumatismes passés va lui permettre de prendre de la distance et de s’apaiser: au fur et à mesure de son parcours, ses relations avec ses proches vont se normaliser et retrouver une tonalité affective plus sereine.
Réactivation traumatique lors de l’annonce d’une maladie létale et résonances périnatales
Sylvie se présente à moi[1] comme une patiente pétillante, drôle et dynamique. Elle a obtenu mes coordonnées par l’intermédiaire d’une de mes collègues psychologues, qui exerce dans un célèbre centre parisien de lutte contre le cancer. À 59 ans, elle me précise n’avoir jamais rencontré de psychologue auparavant, sauf une fois, il y a très longtemps… S’étant retrouvée par hasard dans une soirée avec cette psychologue et son mari, elle s’est dit que ce n’était pas fait pour elle et elle n’a plus jamais réitéré l’expérience. Aujourd’hui, c’est elle qui est à l’origine de notre rencontre, dans le cadre de l’accompagnement psychologique permis par sa prise en charge au sein du DAC[2] de son secteur: suivie pour un “cancer du poumon stade 4, métastatique”, diagnostiqué il y a moins de 18 mois, elle se trouve en colère, intolérante, “chiante” et dit pourrir la vie de tout le monde. Tout le monde, c’est son mari, ses trois fils, dont le dernier vit encore au domicile familial, et même ses amis. Quand elle arrive à moi, Sylvie attend que je lui dise où elle en est, mais sans détruire le “mur” (sic) qu’elle a construit – depuis bien longtemps – pour se protéger. Ce faisant, elle va entrer dans un processus psychothérapeutique de près de deux ans (presque jour pour jour), qu’elle financera en partie (le DAC permettant un accompagnement sur dix séances uniquement).
Au moment de notre rencontre, elle exprime que son état actuel et ses comportements pourraient mettre en péril son couple, ce qui lui fait très peur. D’autant qu’elle me précise qu’elle a le sentiment d’être autocentrée, de ne penser qu’“à sa gueule”. Enfin, l’arrêt conjoint de la cigarette chez elle et son mari depuis le diagnostic de la maladie leur a fait prendre à tous les deux beaucoup de poids. Cette prise de poids, associée à la perte de ses cheveux, l’accable beaucoup. En effet, Sylvie a exercé de nombreux métiers tout au long de sa vie, dont celui de coiffeuse: ainsi, soigner ses cheveux a toujours été, et tout au long de sa vie, une priorité.
Mort subite du nourrisson, interruption virtuelle de grossesse et premières résurgences traumatiques
Très vite, Sylvie m’explique (de manière très factuelle) que son fils aîné, Jonas, est décédé de mort subite du nourrisson à l’âge de sept mois. Son second fils, Jérôme, est né deux ans après: un petit garçon décrit comme hyperactif, ayant vécu une enfance compliquée, avec une maman angoissée, terrifiée à l’idée de perdre à nouveau son second fils. D’un second mariage naîtront deux autres garçons, respectivement huit et quatorze ans plus tard.
Lors de notre second entretien, Sylvie raconte (pour la première fois, me dit-elle) ce qu’il s’est passé au moment du décès de Jonas. Elle était avec son conjoint chez ses parents à elle. Son fils de sept mois et trois jours dormait dans une chambre à l’étage, près de son petit frère à elle, âgé de onze ans à l’époque. Son mari est allé voir leur fils et est redescendu en disant: “il ne respire plus”. Madame lui a répondu quelque chose de l’ordre de “arrête de déconner”, mais elle a perçu, à l’expression de son visage, que c’était sérieux: elle est montée et a redescendu son bébé qui ne respirait plus. Elle se rappelle du personnage de Donald dessiné au feutre sur la blouse de la médecin du SAMU et des pompiers alignés en rang d’oignon, qui ne “bronchaient pas” (sic). En dehors de ces éléments, elle raconte un “trou noir”: elle ne se souvient de rien. Très vite sédatée par les soignants présents sur place, elle ne décrit aucune émotion ressentie, comme si elle s’était absentée de la scène, dans un vécu de déréalisation et de dépersonnalisation (Jean-Dit-Pannel, 2021a), nécessaire à la gestion psychique d’un tel traumatisme. Sylvie m’explique avoir raconté de nombreuses fois son histoire, mais de manière détachée, dès quelques mois après le décès. Au moment du drame, elle ne travaillait plus et élevait son bébé: elle a alors assez rapidement repris son travail après la mort de Jonas (à l’époque, elle était coiffeuse) et racontait à qui voulait l’entendre ce qui était arrivé, comme si mettre en mots l’événement lui donnait une réalité et lui permettait – peut-être – d’essayer de l’intégrer? Néanmoins, la néantisation de la pensée consécutive au traumatisme va de pair avec l’impossibilité de dire le trauma, de le penser (Duchet, 2012). Ainsi, nous pouvons nous interroger sur le contenu des dires de Sylvie: s’agissait-il de propos automatiques et opératoires, racontant les faits sans affects, provoquant la sidération chez ses interlocuteurs, sans jamais permettre une pensée en écho? D’ailleurs, Sylvie évoque bien le fait qu’elle s’est sentie à ce moment de nouveau “libre”, ses propos résonnant de manière très dissonante et comme s’il fallait inconsciemment qu’elle construise un bénéfice secondaire à cette absence.
Environ deux ans après, Sylvie tombe à nouveau enceinte. Elle apprend sa grossesse de manière fortuite, à presque quatre mois révolus: son médecin souhaite alors lui prescrire un traitement pour stopper l’aménorrhée qu’elle vit depuis le décès de son fils. Par acquit de conscience, il demande tout de même un test de grossesse: elle le fait sans conviction et ne va même pas chercher les résultats. Le laboratoire finit par appeler chez elle et tombe sur son mari: celui-ci va chercher les résultats et annonce sa grossesse à sa femme, après lui avoir demandé si elle se sentait bien en ce moment… Elle n’avait absolument rien perçu. Elle évoque son souhait d’IVG, mais il est trop tard, elle n’a plus le choix: “j’étais siphonnée”, dit-elle. Elle me rapporte des angoisses très envahissantes pendant la grossesse et après la naissance. Nous pouvons néanmoins faire l’hypothèse que l’arrivée de ce nouveau bébé a permis à Sylvie la remise en mouvement d’une dynamique psychique permettant d’élaborer la perte et de réactiver un processus de deuil, figé par le traumatisme de la mort de son premier enfant (Soubieux, 2008).
À sept mois, Jérôme va être hospitalisé pour une bronchiolite et une gastro-entérite sévère, le menant à une hyperthermie grave. Le mari de Sylvie dort au moment où elle donne un bain à son fils sur les conseils du médecin du SAMU pour faire baisser la fièvre. L’angoisse majeure ressentie à ce moment entraîne une reviviscence du traumatisme de la perte de Jonas, à un âge identique (quasiment jour pour jour). Ainsi, cet événement résonne comme une mise en scène psychodramatique psychosomatique: cette position hypocondriaque de la mère, qui cherche à excorporer un mal en elle, amène Jérôme à prendre la forme d’un “organe hypocondriaque de la mère” (Szwec, 2002). Cet épisode signera la fin de la relation entre Sylvie et son premier mari.
Maladies somatiques féminines-maternelles et histoire familiale
La mère de Sylvie, dont elle était très proche, est décédée, environ un an et demi avant son diagnostic de cancer, d’une maladie neurodégénérative. Ses enfants avaient alors 34, 26 et 20 ans. En six ans d’évolution de la maladie, la mère de Sylvie s’est “statufiée”, selon les dires de Sylvie (les lésions consécutives à sa maladie ont entraîné une paralysie oculaire, puis ont affecté progressivement l’équilibre, la vue, la marche, la déglutition et la parole), mais en conservant ses capacités cognitives. Selon Sylvie, tout au long de la maladie, son père a tout décidé des soins à la maison. Elle raconte que ce dernier avait des relations sexuelles sous le nez de sa femme avec les auxiliaires de vie, qu’il recrutait selon ses propres critères physiques. Sylvie étant la fille la plus présente, elle est souvent entrée en conflit avec lui. L’ensemble de la prise en charge de sa maman a ainsi été extrêmement compliquée et douloureuse.
Sylvie décrit un père “méditerranéen”, très dur, patriarche et “tout-puissant”. De son enfance, elle retient une injonction récurrente: “Baisse les yeux et arrête de pleurer”. L’imago paternelle du père semble avoir résonné avec l’imago de son premier mari lors du décès de Jonas et de l’épisode traumatique vécu avec Jérôme (lors de l’épisode d’hyperthermie). Sylvie m’avouera à l’occasion d’une séance qu’elle n’a jamais osé le formuler à personne, mais qu’elle s’est souvent interrogée sur la responsabilité du père de Jonas au moment de son décès… Ainsi, la résurgence traumatique de la menace de mort sur Jérôme va entraîner la rupture conjugale.
Sylvie est la seconde d’une fratrie de quatre enfants: elle explique que l’aînée vit à l’étranger depuis ses 17 ans, que le second fils est alcoolique des suites d’un grave accident de voiture, et donc un peu en marge des décisions familiales, que le cadet (le “petit dernier”) est très en retrait. À l’époque de la maladie de sa mère, Sylvie était responsable commerciale dans un centre de formation. Elle a arrêté de travailler un an après le décès de sa mère: une rupture conventionnelle lui a permis d’obtenir trois ans de chômage prévus pour lancer son auto-entreprise de créatrice. Avec son mari, ils ont ainsi dû vendre leur grande maison “coup de cœur” dans laquelle ils vivaient pour déménager dans une maison plus modeste dans un village voisin. À cette période, Sylvie boitait beaucoup, elle était très fatiguée… Le processus de démentalisation (Marty, 1991) repérable ici, face à un cumul trop important de pertes et d’événements traumatiques, apparaît comme pouvant présager de la décompensation somatique, au sens où l’entendait l’École psychosomatique de Paris (IPSO). D’autant que nous pouvons imaginer que la disparition de cette mère, manifestement solide et étayante pour Sylvie (notamment au moment de la mort de Jonas), ait pu entraîner, à travers la disparition des procédés auto-calmants signes d’une présence maternelle suffisamment contenante, une résurgence du vécu traumatique de l’événement surexcitant qu’a représenté la disparition brutale de son fils (Fain, 1992).
Maladie somatique grave et résurgences traumatiques
La période de post-covid et de deuil de sa mère a semblé, pour Sylvie, expliquer ses symptômes. Sa médecin généraliste, en qui elle n’a aucune confiance, ne s’est pas alarmée d’une image pulmonaire problématique. Ayant fini par refaire des examens, elle s’est décidée à consulter un pneumologue, qui l’a adressée à un hôpital parisien. Après quatre mois d’examens complémentaires et d’errance diagnostique, elle est prise en charge dans le grand centre de lutte contre le cancer au sein duquel elle est toujours suivie. Traitée en urgence par chimiothérapie, immunothérapie (celle-ci est encore en cours) et trois séances de radiothérapie pulmonaire, elle m’explique que, désormais, la maladie “dort”. En rémission donc, la surveillance est régulière, en parallèle de l’immunothérapie, toutes les six semaines. Les premiers temps du suivi psychothérapeutique, le discours de Sylvie est très opératoire, sans expression d’affects, conforme à la pensée opératoire décrite par Marty, De M’Uzan et David (1963). Évoquant son incapacité récurrente à pleurer, y compris dans des moments de détresse intense, elle ajoutera: “Ma relation avec les larmes est très compliquée”.
Lors d’une séance, Sylvie évoque pour la première fois (et avec surprise) l’histoire de son amie d’enfance, Paola, qui était enceinte de sept mois lorsque son bébé (Jonas) est décédé. La fille de Paola, Bérénice, s’est – bien plus tard – tuée en scooter à l’âge de quinze ans: Sylvie était alors enceinte de deux mois de son dernier fils. Ces deux situations en miroir sont troublantes et questionnent Sylvie, d’autant que cela lui revient après avoir évoqué le silence de son corps jusqu’à l’âge de 57 ans (elle n’a jamais été malade, n’a jamais eu de problème de santé). En réalité, il semble qu’elle ne lui ait jamais laissé la parole, sans non plus laisser s’exprimer une souffrance psychique qui aurait pu prendre toute la place. Elle reprend alors l’histoire de cette amie, le décès de son fils et celui de sa mère (les larmes montent dès qu’elle l’évoque) et m’explique qu’après le décès de son fils, sa seule crainte (consciente) n’a jamais été de perdre un autre de ses enfants, mais de perdre sa mère. Ce qui est finalement arrivé. Le déni de la peur – de la terreur? – qu’a représenté la menace de mort pesant sur Jérôme au moment de l’épisode somatique aigu survenu à l’âge de sept mois, semble avoir été nécessaire à la gestion de la potentielle survenue d’un nouvel état de sidération psychique, en écho à celui vécu lors du décès de Jonas.
Par la suite, et en parallèle de l’évolution de sa maladie, Sylvie va progressivement aborder des sentiments et affects plus sensibles en évoquant notamment à quel point il lui est difficile de vivre avec l’idée qu’elle va mourir: elle me répète les mots de ses médecins, à savoir qu’elle “ne guérira pas”. Ne pas pouvoir se projeter et ne pas avoir de délai est difficile, même si elle sait que le contraire est impossible. Elle évoque les médecins qui donnent une fourchette d’espérance de vie, les malades du réseau MRCP (Mon Réseau Cancer Du Poumon) qui n’ont jamais plus de quatre ou cinq ans d’“ancienneté”… Elle ajoute même avoir dépassé son espérance de vie théorique par rapport au pronostic de sa maladie. Elle me raconte un jour qu’ils ont toujours plaisanté avec son mari en s’imaginant vieux, lui avec une casquette et un marcel et elle une blouse à fleurs. Elle ajoute qu’elle sait désormais qu’elle n’aura pas de vieillesse et se demande si elle doit “accepter” tout ça. Elle se questionne sur tous les “psys” (ou simili-psy) qui amènent à chercher un sens positif aux événements: cela la met en colère, elle me raconte avoir tout entendu, notamment autour de la mort de son fils (“Une étoile près de Dieu”, “une résurrection sous une autre forme par la suite”, etc.). Ainsi, l’injonction à donner du sens et à entendre l’événement traumatique (maladie et/ou perte) comme un événement enrichissant, au sens du courant doloriste réfuté par Ogien (2017), résonne pour Sylvie comme une intolérable commande. De la même façon qu’une protocolisation psychique de la maladie grave serait à craindre (Peyrat-Apicella, 2022), la potentielle protocolisation psychique du trauma revêt un caractère intolérable pour Sylvie.
Par ailleurs, Sylvie parle beaucoup de l’hyperactivité de son second fils, Jérôme, qui l’a “maintenue en vie”: son agitation semble prendre la fonction d’une tentative de réanimation psychique. À l’instar de Gayané, la petite fille évoquée par Françoise Neau dans son article de 2015: «Comment ne pas entendre la dimension antidépressive dans ce débordement d’activités, dans ces défis, dans cette affirmation de la toute-puissance de la libido narcissique sur “le destin”, ou sur “le monde extérieur”, ou plus précisément sur la nécessité, ce que Freud appelle l’ananké, autrement dit l’exigence que la réalité externe exerce sur l’appareil psychique?» (p. 111). L’hyperactivité de Jérôme semble en outre apparaître en miroir de celle de sa mère, qui n’a eu de cesse depuis le décès de Jonas de sortir, multiplier les activités professionnelles et extra-professionnelles, comme elle le fera d’ailleurs toute sa vie, jusqu’à ce que son corps lui pose une limite, en se mettant à suffisamment dysfonctionner pour ne plus lui permettre de (sur)agir à sa guise.
Elle reparle de cette “psy” qu’elle déteste, qui a annoncé à Jérôme (en sa présence, mais sans l’avoir prévenue) qu’il avait un frère aîné qui était mort, et que le bébé en photo dans le salon n’était pas lui (manifestement, Jonas et Jérôme se ressemblaient beaucoup). Sylvie pleure beaucoup. C’est la première fois depuis que nous nous connaissons (le travail a débuté depuis un peu plus d’un an). Selon elle, si elle en avait parlé par le passé, elle aurait ouvert la “boîte de Pandore” et elle se serait effondrée. Cette évocation nous semble renvoyer à la crainte d’une contamination, comme si parler des événements traumatiques pouvait risquer de libérer des angoisses insurmontables: «Ce travail analytique est semblable à l’ouverture d’une boîte où des éléments non symbolisables sont libérés, pour que le patient puisse les intégrer» (Bion, 1962, p. 104). Sylvie raconte qu’après la mort de son fils, elle ne se rappelle plus rien, de ce qu’elle a fait, d’où elle était: sa mère parlait d’elle comme d’une “zombie”. À ce moment-là, le caractère traumatique du décès de son fils semble assurément «non traitable psychiquement» (Neau, 2015, p. 110).
Ainsi, tout se passe comme si la maladie réactivait cet état de sidération psychique, d’anesthésie de la pensée (et des émotions?). À propos de l’anesthésie de ses émotions, elle se dit anesthésiée par son état de malade (de mourante?). Elle explique à quel point elle est “diminuée”, marchant comme une “mamie”, avec des nausées et très peu d’énergie. Elle raconte comment son mari et son fils sont aux petits soins pour elle: elle pense que ce doit être dur pour eux, qu’elle leur impose quelque chose de pénible. Lorsque je pointe qu’ils peuvent (enfin) prendre soin d’elle, elle acquiesce en me disant que son mari est un “sauveur” (il est pompier) et qu’il prend plaisir à prendre soin d’elle. Mais que ce sera d’autant plus dur pour lui après, puisqu’il ne pourra pas la sauver. Elle explique alors qu’il lui semble que c’est dans l’émotion de l’autre (ou qu’elle projette sur l’autre?) qu’elle peut vivre ses émotions. Ainsi, tandis qu’elle refusera d’évoquer le sujet de la mort de Jonas durant la fin de ma grossesse (qui survient durant le suivi de Sylvie) et les premiers mois de mon bébé, afin de me préserver d’angoisses relatives aux drames périnataux qui peuvent survenir, elle s’effondrera lorsque je laisserai entendre qu’elle ne connaît pas mon vécu et qu’il n’est peut-être pas possible de me protéger.
L’incertitude relative à sa situation est insupportable pour Sylvie: perdre (ou pas) ses cheveux, que le traitement soit efficace (ou pas), que la maladie évolue (ou pas). Cette incertitude est douloureuse, d’autant que Sylvie ne se sent pas malade, sauf quand elle est en traitement. En effet, excepté quand elle est en chimiothérapie ou en radiothérapie, elle trouve qu’elle va bien (ce que lui renvoie son entourage) et finit par se demander si les médecins ne se sont pas trompés (est-elle vraiment malade?), comme si une forme de contamination psychique résultait de l’incertitude relative à la maladie (Bioy, 2003). Au fond, elle sait bien que oui, mais elle aurait envie de penser que non… La notion d’espoir semble ici fondamentale à convoquer, au sens où elle appelle une tentative de mouvement: «espérer, c’est chercher, cheminer, aller vers» (Le Berre et al., 2024). Par ailleurs, l’espoir, c’est aussi «avoir confiance dans l’avenir, dans la vie; entrevoir que la vie ne se termine pas dans le néant mais qu’il y a survie de l’individu (par la descendance, la vie future)»[3]. Au fur et à mesure de l’évolution de la maladie les mois suivants, des rechutes et annonces de nouvelles localisations métastatiques, elle décrit un état “entre deux”, ni vraiment morte, ni vraiment vivante (Jean-Dit-Pannel, 2021b). L’idée même de devenir dépendante est intolérable pour elle.
Lorsque des vécus familiaux cryptent le corps-soma du sujet: quelle névrose de destinée familiale?
Dans ces entre-deux, voire antre-deux, quid ici de l’enchaînement de ces situations traumatiques faites de la mort d’un enfant, d’une rupture conjugale puis de la mort d’une mère? Sylvie a été à ces différents moments de vie, et surtout après la mort de son fils, dans cet entre-deux, à savoir ni morte ni vivante, une “zombie”, comme la décrivait sa propre mère. Lorsqu’un travail de deuil ne peut que difficilement s’élaborer, ici d’autant plus dans une situation de deuil périnatal, un travail de mélancolie est à interroger (Freud, 1917). D’ailleurs, celui-ci peut s’adjoindre à un travail de somatisation (Smadja, 2013; Jean-Dit-Pannel, 2022), par l’excès économique d’un trauma. L’hypothèse soutenue ici serait que, outre la concomitance de ces deux mouvements, on pourrait faire l’hypothèse d’un lien de cause à effet entre traumas et mélancolie, puis entre multiplicité des traumas et somatisation. En effet, ces successions de pertes alimenteraient une opératoirisation (Jean-Dit-Pannel, 2014) du fonctionnement mental du sujet. Se questionnent alors des névroses de destinées familiales (Jean-Dit-Pannel et al., 2022) avec leurs enjeux corporo-somatiques: le corps familial est ainsi individuellement, groupalement, porteur des impensés traumatiques de ce qui peut faire symptôme, corporellement, somatiquement, générer une ou des décompensations somatiques par débordement économique. Ici, des vécus familiaux cryptent le corps-soma du sujet, l’opératoirisent pour – et c’est là notre supposition – favoriser une décompensation somatique. Comme nous l’avons rappelé avec Szwec et son hypothèse d’un enfant-organe hypocondriaque de sa mère, le sujet reste toujours un membre, un organe d’un corps familial (Cuynet, 2010), d’un arbre généalogique aux différentes parties dont certaines sont déjà mortes. Alors que le fils et la mère de Sylvie sont déjà morts, son pronostic vital à elle est engagé à court terme: néanmoins, nous pouvons nous demander si elle est encore bien vivante psychiquement… L’enracinement corporo-familial, selon notre proposition en appui sur la réflexion de Chapelier (2011), se trouve nécessairement questionné: en d’autres termes, quels liens et quels rapports sont à penser entre la place de Sylvie en tant que mère et fille, les traumas multiples (succession de pertes) et l’atteinte corporelle qui met en jeu aujourd’hui la survie de Sylvie? Entre fantasmes et réalités, les enchevêtrements, les hypothèses diverses et les angoisses nous donnent à penser autour de cette situation, sans que nous puissions réellement détricoter l’ensemble de ses enjeux et des pulsions à l’œuvre pris entre des mouvements de vie et de mort visibles dans l’histoire de Sylvie.
Conclusion
L’analyse de cette situation clinique, outre le fait qu’elle appuie notre hypothèse du caractère traumatique que prend l’“événement-maladie” dans le parcours d’une patiente au vécu jalonné de traumas non élaborés (Peyrat-Apicella et Pommier, 2018), nous donne à penser différentes pistes concernant l’impact des pertes, deuil et ruptures sur l’équilibre psychosomatique du sujet. Par ailleurs, la complexité des événements et la difficulté à élaborer des situations extrêmes qui s’entremêlent (mort subite d’un fils de 7 mois [Touvenot, 1997], maladie chronique grave et évolutive chez une mère, rupture et doute autour de comportements inadéquats chez un ex-mari) nous amènent à laisser ouvertes les pistes de réflexion abordées et à poursuivre la réflexion, notamment du côté d’éléments transféro-contre-transférentiels essentiels à explorer. En effet, Sylvie est décédée pendant l’écriture de cet article: nous devions nous revoir au sein de l’USP[4] dans laquelle elle venait d’être transférée, nous avions pris rendez-vous. Elle est décédée le matin même, sans que nous ne puissions nous revoir.
Bibliographie
Bion, W. (1962). Aux sources de l’expérience. Paris: PUF, 2003.
Bioy, A. (2003). La souffrance psychique et le cancer: une approche psychanalytique. Malakoff: Dunod.
Bonnet, M., Vadam, F., Belot, R.-A., Quibel, C., Pozet, A. et Nerich, V. (2020). Attachement et parcours de l’aidant face à l’épreuve du cancer. Bulletin du Cancer, 107(11), 1138-1147.
Chapelier, J.-B. (2011). Du corps individuel au corps groupal: au-delà d’une métaphore? Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 57(2), 9-21.
Cuynet, P. (2010). Lecture psychanalytique du corps familial. Le divan familial, 25(2), p. 11-30.
Duchet, C. (2012). Cliniques traumatiques en situations extrêmes. In V. Estellon et P. Marty (sous la dir. de). Cliniques de l’extrême (pp. p. 219-229). Paris: Armand Colin.
Fain, M. (1992). La vie opératoire et les potentialités de névrose traumatique. Revue française de psychosomatique, 2(1), 5-24.
Freud, S. (1917). Deuil et mélancolie. Paris: Payot, 2011.
Jean-Dit-Pannel, R. (2014). Dialyse péritonéale et hospitalisations lors de l’entrée dans l’adolescence à propos d’Ella. Enfances &PSY, 62(1), 180-188.
Jean-Dit-Pannel, R. (2021a). Périnatalité et Corps-Cadavre. In D. Peyrat-Apicella et A. Sinanian (sous la dir. de). Situations extrêmes (pp. 77-85). Paris: In Press.
Jean-Dit-Pannel, R. (2021b). Sur-vivre (sus)pendu à des objets étrange(r)s, Approche psychopathologique du sujet en insuffisance rénale chronique et dialysé. Dans P. Brun (sous la dir. de) Du nouveau dans la psycho (pp. 178-193). Nîmes: Champ social
Jean-Dit-Pannel, R. (2022). De la mélancolie à la maladie somatique chronique. Cliniques méditerranéennes, 106(2), 115-128.
Jean-Dit-Pannel, R., Belot, R.-A., Vidal-Bernard, A. & Sanahuja, M. (2022). Une névrose de destinée familiale: clinique des maladies rénales génétiques et héréditaires. Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 79(2), 203-215.
Le Berre, R.; Prod’homme, C.; Zimowski, J.; Loisel-Buet, C.; Séna, N. et al. (2024). L’espoir au cœur de l’expérience du soin: du curatif au palliatif. Médecine Palliative, 23/2, 107-116.
Marin, C. (2014). La maladie, catastrophe intime. Paris: PUF.
Marty, P. (1991). Mentalisation et psychosomatique. Paris: Les empêcheurs de penser en rond.
Marty, P.; De M’Uzan, M. et David, C. (1963). L’investigation psychosomatique. Paris: PUF, 2015.
Neau, F. (2015). Du traitement psychique d’événements traumatiques. Cliniques méditerranéennes, 91(1), 109-122.
Ogien, R. (2017). Mes Mille et Une Nuits – La maladie comme drame et comme comédie. Paris: Albin Michel.
Peyrat-Apicella, D. (2020). Donner du sens à la maladie grave: représentations et théories explicatives en cancérologie. Lyon: Chroniques Sociales.
Peyrat-Apicella, D. (2022). Sens et histoire de la maladie. Dans D. Peyrat-Apicella et et S. Gautier (Dir.). Place du psychologue et complexités en soins palliatifs (pp. 57-66). Paris: In Press.
Peyrat-Apicella, D. et Pommier, F. (2018). Quand l’«événement-maladie» fait trauma à propos d’un cas clinique. Psychothérapies, 38(1), 47-53.
Smadja, C. (2013). Deuil, mélancolie et somatisation. Revue française de psychosomatique, 44(2), 7-24.
Soubieux, M.-J. (2008). Le berceau vide. Toulouse: Érès, 2016.
Szwec, G. (2002). L’enfant – Organe hypocondriaque de sa mère. Revue française de psychosomatique, 22(2), 65-83.
Touvenot, V. (1997). Approche psychodynamique de la mort subite du nourrisson. Psychologie clinique et projective, 3, 127-156.
* Psychologue clinicienne et maîtresse de conférences en psychologie, Unité transversale de recherche psychogenèse et psychopathologie, UTRPP, UR 4403, Université Sorbonne Paris Nord, 93430 Villetaneuse, France. delphine.peyratapicella@univ-paris13.fr
** Professeur de Psychopathologie et de Psychologie Clinique Psychanalytiques à l’Université Marie et Louis Pasteur, Laboratoire de Psychologie (UR 3188), F-25000 Besançon, France. Directeur adjoint du laboratoire de Psychologie. Membre de la WAIMH-France et de la Société internationale de psychanalyse familiale périnatale. romuald.jean-dit-pannel@univ-fcomte.fr
[1] Patiente rencontrée par Delphine Peyrat-Apicella. Nous présentons à la première personne pour être plus représentatifs d’un temps de rencontre clinique.
[2] Dispositif d’appui à la coordination: dispositif départemental résultant de la fusion des MAIA, des réseaux de santé et des plateformes territoriales d’appui.
[3] Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales – CNRTL
[4] Unité de Soins Palliatifs.