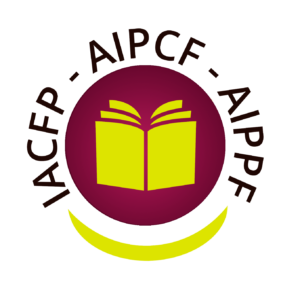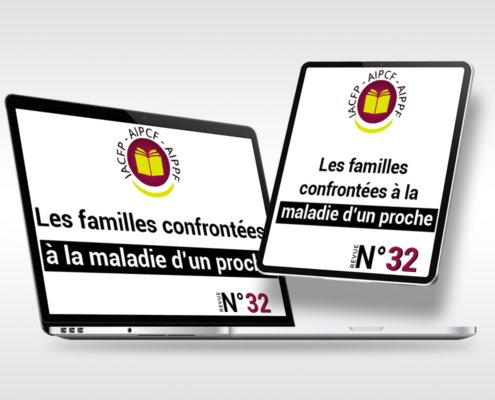REVUE N° 32 | ANNE 2025 / 1
INTRODUCTION N°32
Introduction au numéro “Les familles confrontées à la maladie d’un proche”
Irma Morosini*, Almudena Sanahuja**, Margaux Bouteloup ***
Le thème de ce numéro porte sur les mouvements psychiques internes et groupaux que traverse la famille lorsqu’elle est confrontée à la réalité de la maladie d’un proche. Le processus de la maladie comprend une temporalité spécifique et complexes qui débute par les inquiétudes autour de premiers symptômes, les investigations médicales, jusqu’à l’obtention d’un diagnostic. Certaines situations – dès l’annonce de la maladie – peuvent susciter des peurs, des angoisses, des représentations mortifères. De même, la douleur psychique partiellement partagée peut entraver le présent et la projection dans un avenir possible. En effet, la famille, paralysée dans un espace de temps figé, assume un certain degré de responsabilité face aux niveaux de dépendance provoqués par la maladie. Les membres de la famille peuvent être accablés par des sentiments de culpabilité, d’impuissance et d’hostilité, et rechercher la distanciation et/ou la surprotection. Les étapes successives des traitements, les progrès et les reculs face à un corps qui répond ou non aux traitements, soutiennent ou compliquent la façon d’aborder le processus vers la guérison, lequel nécessite une famille qui accompagne, soutient et encourage. Des familles peuvent le faire et d’autres non ; certains membres prennent en charge et d’autres ne supportent pas l’idée et les effets d’une maladie qui s’aggrave et invalide. Dès les effets potentiellement traumatiques de l’annonce de la maladie, la famille est contrainte à une adaptation, laquelle se poursuit avec la durée d’une maladie psychique et/ou somatique grave d’un membre de la famille. La maladie physique affecte le psychisme, et vice versa, et peut entraîner un handicap du membre concerné, altérant autant sa propre organisation que celle du groupe familial. L’expérience de la maladie concerne la subjectivité du patient dans son fonctionnement psychique, ses mécanismes de défense et son histoire personnelle et familiale. Mais elle concerne aussi sa famille. Des anxiétés infantiles, des croyances, des modèles d’attachement, la place dans l’environnement familial et social sont mobilisés. Le sens donné à la maladie dépendra des facteurs conscients et inconscients qui sont en jeu, dont certains trouvent leur origine dans l’histoire familiale. Ce processus mobilise capacités de mentalisation – tant du patient que du groupe familial – qui influenceront la capacité à traiter et à gérer la douleur psychique et somatique que la maladie peut générer pour chaque subjectivité et pour la famille. Le processus affecte le patient et mobilise la famille, perturbant l’homéostasie du groupe, générant des mouvements de régression et de fusion, ainsi qu’un risque de rejet du malade, par crainte que l’intégrité du groupe familial ne soit atteinte ou rompue. Lorsqu’une famille souhaite un soutien pour faire face à ces processus et aider le patient, un cadre thérapeutique est nécessaire. Le groupe familial dispose ainsi d’un espace d’écoute. En effet, les aidants familiaux sont au centre des préoccupations de santé publique car le soin à apporter à un membre du groupe gravement malade nécessite une énergie et une disponibilité spéciales. Prendre soin de l’aidant est aussi une tâche qui mérite réflexion. L’espace thérapeutique permet aux membres du groupe d’exprimer leurs sentiments, de clarifier leurs doutes, de s’écouter et de confronter leurs positions, leurs fantasmes et leurs disponibilités, avec l’objectif thérapeutique de se renforcer en tant que réseau de soutien contenu par l’équipe soignante. L’écoute psychanalytique et l’attention portée à la réactivation de l’attachement, à la mentalisation, à la réflexivité et à l’associativité soutiendront ces processus dans le travail en thérapie familiale psychanalytique.
L’article de Delphine Peyrat-Apicella et Romuald Jean-Dit-Pannel, «Irruptions d’interruptions involontaires de vie : résurgences traumatiques, maladie somatique grave et résonances périnatales», met en évidence, à partir d’un cas clinique, la façon dont une maladie grave telle que le cancer peut entraver le soutien familial apporté au membre malade, qui, en raison de sa fragilité psychique, ravive des expériences familiales de pertes. Cette souffrance passée, non traitée, engendre une agressivité du malade envers sa famille, ce qui la maintient à distance.
À partir de ce phénomène, les auteurs s’interrogent sur les névroses de destin familial, en s’appuyant sur les enjeux corporels-somatiques où le corps individuel devient porteur de l’histoire familiale et de ses processus traumatiques impensés, pouvant se manifester par des symptômes corporels ou somatiques, générant une ou plusieurs décompensations somatiques liées à un débordement économique.
Cristina Calarasanu, dans «Once upon a time there was a child… or not? Urgency and the emergence of time in psychoanalytic family psychotherapy» montre comment deux dimensions du temps – urgence et émergence – interagissent. En s’appuyant sur un cas clinique relatant les effets sur une famille de l’annonce d’un diagnostic de «mort» imminente à la naissance de leur enfant, trois ans auparavant, l’auteur illustre de quelle façon l’espace thérapeutique devient un champ temporel unique où le passé, le présent et l’avenir se croisent, permettant aux familles de reconstruire des récits et de développer un nouveau rythme de vie.
L’article de Christopher Vincent «Couple psychotherapy in the shadow of illness» explore l’impact de la maladie sur le sujet mais également sur la relation de couple dans une perspective psychanalytique. Il expose les théorisations de Frank autour de la narration et de Toombs autour de la phénoménologie de la maladie d’un point de vue individuel et propose d’appliquer ces deux théories à l’objet couple. À partir de deux situations cliniques, l’auteur expose la façon dont le couple fait face à une maladie grave d’un de ses membres, dont il gère la perte et les réajustements imposées par la maladie et la façon dont les défenses individuelles et couplales vont être mobilisées durant cette épreuve et lors de la thérapie de couple.
L’article d’Alberto Treyssac, «Talleres psicoterapéuticos con familias de pacientes internados», traite du travail qu’e l’auteur mène avec les familles de patients hospitalisés pour un handicap mental modéré à sévère, souvent associé à d’autres pathologies organiques. Les patients sont admis dans un foyer avec centre de jour, où les familles ont pris la décision de l’internement, n’étant plus en mesure de répondre aux besoins de leurs enfants. L’auteur expose les divers motifs ayant conduit à cette décision, les difficultés rencontrées par les familles, ainsi que la nécessité de partager et de trouver du soutien au sein de l’institution, en créant des réseaux avec d’autres familles pour former un nouveau groupe. Lors des ateliers multifamiliaux, les participants ont exprimé leurs expériences, leurs sentiments, leur frustration, leur impuissance face au silence social. L’auteur souligne l’importance de la construction d’un réseau de fratrie, car ce sont les frères et sœurs qui assurent le relais du soutien lorsque les parents ne sont plus là.
L’article de Manon Gibault, Magalie Bonnet et Almudena Sanahuja «L’enveloppe psychique familiale à l’épreuve du cancer» interroge les effets de la maladie grave sur le groupe familial et son enveloppe psychique groupal. Au travers d’outils projectifs familiaux (génographie et spatiographie projectives), les auteurs illustrent comment le cancer affecte non seulement le sujet mais aussi le couple et le corps familial au long cours, venant réinterroger l’équilibre et les dynamiques – entre isomorphie et homomorphie – installées avant la maladie. A partir d’un cas clinique familial, les auteurs illustrent la façon dont l’enveloppe psychique familiale est significativement atteinte par l’épreuve du cancer, à la fois dans sa fonction de protection contre les excitations extérieures et dans sa fonction de réceptivité pour intégrer les expériences traumatiques vécues par la famille.
L’article de Liz Slater, Caroline Finill, Patsy Ryz et Wayne Bodkin «Living with illness in the couple: Clinical reflections from a Special Interest Group » expose le travail fécond à l’œuvre au sein de leur Groupe d’Intérêt Spécial (SIG d’étude sur la maladie, le couple et la thérapie de couple, cette clinique nécessitant de créer des espaces de pensées particuliers. Le SIG est présenté par les participants comme une expérience personnelle dans un contexte clinique. L’objectif de ce SIG est de partager du matériel clinique et de développer une compréhension à la fois émotionnelle et théorique des situations complexes rencontrées par chacun des thérapeutes. À partir de l’exploration de quatre thématiques – la démence, le suicide, la vulnérabilité du thérapeute, le contexte sociétal et l’interface entre l’expérience clinique et l’expérience personnelle – les auteurs illustrent comment ce dispositif devient un espace de contenance et de créativité à la fois personnel et professionnel pour chacun d’eux.
Fernando Da Silveira, dans «The metapsychology of the third kind and the clinic of the cure-type: The care of a young adult with mental illness in the family» met en lumière une proposition originale de soin pour un adolescent atteint d’une maladie psychique en s’appuyant sur la pratique clinique psychanalytique contemporaine.
Cette pratique postule que la psyché s’étend au-delà de l’intrapsychique, que les fondements narcissiques de l’être reposent sur des supports métapsychiques et métasociaux, et que l’effondrement de ces supports met en péril l’existence psychique même du sujet. Pour garantir l’efficacité du travail analytique, cette proposition de soin implique la mise en place de différents espaces de soutien multi-subjectifs destinés à renforcer l’espace intrapsychique de l’adolescent : des réseaux de soutien psychique, familial, communautaire et social.
Dans la section Hors-thème, Jill Scharff nous présente un article intéressant intitulé «Difficult brief therapy with a chinese couple», relatant un processus mené avec un couple selon une approche nouvelle et inhabituelle: deux thérapeutes travaillent ensemble, avec l’aide d’un interprète, sur une courte période de cinq séances. Il s’agit d’un couple issu d’une culture aux normes et repères différents. Ce couple, déjà en traitement avec l’un des thérapeutes, accepte de participer à cette proposition dans l’espoir de solutions rapides. La présentation, riche et détaillée, s’appuie sur des transcriptions de séances permettant d’illustrer la dynamique particulière de ce type de prise en charge. Elle met en lumière les mécanismes qui influencent et déterminent une issue inattendue, différente de celle initialement recherchée. L’expérience clinique décrite permet de tirer des enseignements de situations complexes et de processus susceptibles d’être interrompus.
Dans la section Dictionnaire, Jean-Pierre Caillot nous propose le concept de «L’incestuel» de Paul-Claude Racamier pour en revisiter la portée. Il en retrace l’historique, évoque les questions suscitées par ce concept et met en évidence l’importance qu’elles ont prise dans la compréhension approfondie de certaines manifestations cliniques chez les patients et dans leurs familles.
Dans la section Notes de Lecture, on trouvera des commentaires sur des livres et un film.
Martha Doniach commente l’ouvrage de Perrine Moran, publié en 2025, intitulé Love Songs: Listening to couples, dans lequel l’auteure articule de manière créative sa formation en arts et en lettres, en soulignant le rôle de la musique dès la vie intra-utérine. Elle développe une réflexion centrée sur le lien, et particulièrement sur la relation de couple, illustrée à travers des paroles de chansons. Clinique et art s’entrelacent sous la plume de l’auteure. La présentation de Martha Doniach donne fortement envie de lire Perrine Moran dans toute sa richesse, et montre comment l’auteure, avec ses connaissances et sa pratiques clinique, déploie un haut niveau académique alliant rigueur professionnelle et exquise sensibilité.
Margaux Bouteloup a recensé l’œuvre (livre et film) Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult (2007). Elle met en lumière, d’une part, une question « taboue » : celle du «bébé-médicament», conçu spécifiquement pour occuper une place bien déterminée au sein de sa famille – celle de sauver de la mort un membre de la fratrie malade, en l’occurrence sa sœur malade –, et d’autre part, les enjeux psychiques familiaux ainsi que ceux du membre «sauveur», qui, en grandissant, rejette cette place assignée, affrontant les alliances inconscientes et le contrat narcissique familial, pour tendre vers ses propres choix autonomes.
Nilton Bianchi a recensé l’ouvrage dirigé par Adriana Navarrete Bianchi et Paulina Zukerman, intitulé Psychanalyse de la famille et du couple. Réflexions latino-américaines , publié par les Éditions Blucher en 2024. Dans ce livre, les autrices présentent le travail de la Commission de Psychanalyse de la Famille et du Couple de la FEPAL entre 2022 et 2024. L’ouvrage aborde des thèmes qui concernent et affectent l’être humain de la postmodernité, face aux défis relationnels et familiaux dans un contexte historico-social en profonde mutation. Il explore les processus propres à la psychanalyse du couple et de la famille face aux changements actuels, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives. Le livre est publié en espagnol et en portugais, ce qui reflète la volonté de diffusion et de compréhension d’une vaste région intégrant les sociétés latines d’Amérique et d’Europe.
La note de lecture de Ellen Jadeau sur l’ouvrage de Monique Dupré la Tour À l’écoute du couple (2025) interroge la construction de la clinique du couple, son cheminement et ses achoppements en lien avec les évolutions de la société, les mutations contemporaines qui la traversent et les institutions qui la composent. Différentes postures et attitudes selon le contexte, le métier, l’ancrage théorique ou la demande sont explorées, illustrant la multiplicité de cette clinique se rapprochant d’une clinique du groupe. Que le professionnel soit thérapeute, écoutant ou conseiller conjugal et quel que soit son ancrage théorique, l’auteur invite ce dernier à réfléchir au cadre, au contrat, au dispositif et au positionnement clinique qui l’anime dans la rencontre des couples. Il est aussi question de la distance, de l’implication personnelle et du vécu du professionnel qui interroge la nécessité d’un travail personnel analytique pour écouter les couples afin de limiter le risque d’entrer dans une forme de confusion.
* Diplômée en Psychologie (UBA). Directrice de Psychodrame. Spécialiste en Psychanalyse de Famille et de Couple. Enseignante à l’Université de Buenos Aires et à l’Université Catholique Argentine (premier et troisième cycles). Membre de l’IAGP; de l’AIPPF; de l’AAPFyP. Fait partie du Comité de Rédaction et du Secrétariat de Rédaction de la Revue Psychanalyse & Intersubjectivité. Directrice de la Revue de l’Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille. Ancienne membre du Conseil d’Administration et Vice-présidente de l’AIPPF (langue espagnole). Auteure du livre Clínica de la Terapéutica Familiar, EAE, 2020. irmamorosini@hotmail.com; ilmorosini@gmail.com
** Professeur de psychologie clinique et psychopathologie, laboratoire de psychologie (EA 3188), psychothérapeute familiale et psychologue clinicienne. maria.sanahuja@univ-fcomte.fr
*** Psychologue clinicienne, Maître de conférences en Psychologie clinique, Laboratoire de Psychologie EA3188, Université de Franche-Comté ; collaboratrice scientifique, Université de Genève. margaux.bouteloup@univ-fcomte.fr