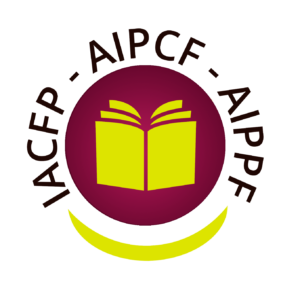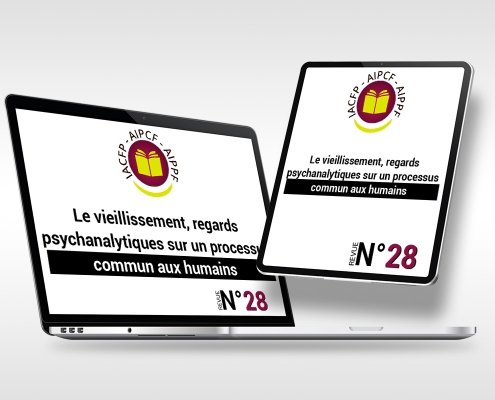ARTICLE
Introduction au numéro “Le vieillissement, regards psychanalytiques sur un processus commun aux humains”
Irma Morosini, Anne Loncan , Alejandro Klein
Ce numéro est consacré au vieillissement, un processus qui ne concerne pas seulement l’humanité du fait de son évolution, mais implique également divers aspects qui invitent à une réflexion plus élargie et approfondie. Car les changements qui surviennent affectent les cultures, les modes de pensée, les besoins, et divers facteurs qui s’imposent selon les idéologies. Mais le plus grand défi que la connaissance de la psychanalyse présente à propos de la vie du sujet âgé, affecté par la sénescence, est de montrer que la flamme du désir brûle toujours et qu’elle est vitale pour chaque subjectivité. S’interroger sur la durée de la vie n’est pertinent que si la qualité et le sens de la vie sont abordés, au-delà de la question du temps. Il apparaît nécessaire d’apporter notre contribution pour alerter le public, repenser les changements sociaux, étudier les besoins et les nouvelles possibilités d’y répondre.
Le vieillissement est un processus subjectif, qui fait partie de la vie elle-même et, en tant que tel, il comporte des phases de continuité et/ou de ruptures relatives à l’identité du sujet, au fonctionnement du groupe familial et aux relations intersubjectives, avec
des effets de réciprocité aux niveaux social et culturel. Son étude nécessite d’être élargie aux processus qui affectent non seulement le sujet, mais aussi son couple, sa famille et ses partenaires institutionnels.
La temporalité, les changements liés à notre époque, les situations propres à un couple et/ou une famille marquent l’histoire de vie de chacun et sont autant de facteurs influant sur les positions narcissiques et objectales lors du vieillissement. Sans être pathologique en elle-même, cette phase évolutive est traversée par divers conflits et pathologies, dont celles qui menacent la santé mentale. De nombreux aspects de la vie psychique sont affectés, exigeant un travail de reconfiguration des liens et des alliances préexistants, sachant que l’appui sur les liens aux autres et à soi-même reste prépondérant.
Il importe donc de poursuivre les recherches relatives à la psychanalyse des liens, aux habitudes de vie dans les familles, où la part des fonctions grand-paternelles est grandissante. Les effets psychiques du vieillissement sont à repérer en termes non seulement de subjectivation, mais aussi de liens intergénérationnels. Il est à souligner que la transmission, sous diverses formes, dont l’héritage matériel, se joue entre ancêtres et héritiers en impliquant plus de générations qu’autrefois.
Par ailleurs, le monde d’aujourd’hui se montre plus attentif à la prévention du déclin dans la vieillesse, développant des expériences dans ce sens. Observerait-on, de ce fait, des remaniements identitaires? l’émergence de formes inédites de subjectivité? Voilà pourquoi il importe de renouveler des connaissances sur le grand âge, à la fois à partir de la psychanalyse des liens et des modalités de vie et de liens dans les familles (y compris les grands-parents, arrière-grands-parents, petits-enfants et arrière-petitsenfants), en étudiant les processus à l’œuvre dans la subjectivation, l’évolution des liens intergénérationnels, en abordant le sens actuel de la famille et les voies qu’emprunte la transmission d’un héritage où interfèrent ancêtres et héritiers.
Le but de ce numéro est de traiter ces questions d’un point de vue psychanalytique, sans fracas, mais sans crainte d’aborder la réalité, afin d’apporter des réflexions originales et de fournir des éclairages sur ce processus universel et complexe. Il est destiné principalement aux thérapeutes de couple et de famille lorsqu’ils sont face à des sujets âgés, ou encore lorsque leurs patients affrontent la sénescence de leurs parents, mais il vise aussi à intéresser tout soignant que sa pratique conduit à rencontrer des personnes âgées, isolément ou en famille.
À cette fin, le numéro réunit des articles qui traitent de ces aspects sous forme de contributions théoriques et/ou cliniques.
Il est à remarquer que le thème de ce numéro n’a pas suscité l’intérêt escompté auprès des thérapeutes qu’il concerne, auprès des auteurs potentiels qui sont ou seront personnellement confrontés à ce processus dans leur couple ou leur famille. Il est permis de penser qu’une certaine réticence s’est marquée à l’égard du concept même, reflet probable de la répulsion, voire de l’effroi, que suscite la dégradation visible chez les personnes âgées. Pour autant, la littérature psychanalytique n’est pas muette à ce sujet et elle nous a permis d’inclure plusieurs articles qui ont déjà été publiés, outre les articles originaux. C’est là une façon de mettre en évidence la transmission intergénérationnelle et de la faire vivre. Au moment où nous préparions cette introduction, le décès de Roberto Losso, survenu le 22 juin 2023 à l’âge de 95 ans, nous rappelle que si la finitude est notre lot commun, elle conclut un processus, le vieillissement, qui affecte chacun et sa famille de manière très inégale. Étant l’auteur avec son épouse Ana de l’un des textes republiés dans ce numéro, il a fait montre d’une vivacité intellectuelle préservée dans le grand âge. Nous le remercions à titre posthume.
Afin de lui rendre hommage, ce numéro 28 présente tout d’abord «Abuelos y nietos hoy: la “abuelidad”», où Roberto Losso et Ana Packciarz Losso reprennent le concept de grand-parentalité pour désigner la relation et la fonction des grands-parents envers leurs petits-enfants et les effets psychologiques des liens qui les unissent. Selon les auteurs, ce concept est lié à la fonction de transmission du savoir du passé à la génération des petits-enfants. Ils repèrent diverses situations de la vie familiale qui empêchent une bonne communication intergénérationnelle entre grands-parents, parents et petits-enfants, par exemple lorsque les petits-enfants sont considérés par les autres générations comme un trophée à se disputer, tel un enjeu de la jalousie ou lorsque le narcissisme excessif des grands-parents limite le rapprochement avec leurs petits-enfants. D’autres circonstances sont par ailleurs estimées favorables, lorsqu’il existe un bon contact entre les grands-parents et les petits-enfants. Les deux générations en sont enrichies: les grands-parents sont alors comme des «narrateurs» de la saga familiale et des porteurs des mythes trophiques des origines. Face aux défis de la société actuelle, les petits-enfants peuvent fournir les forces vitales opposées aux forces destructrices en action. Enfin, les auteurs soulignent que l’approche trigénérationnelle dans la clinique peut aider à traiter de nombreux conflits entre les générations.
Daniela Lucarelli propose ensuite un texte original, «The ageing couple: the need for changing the links and the unconscious alliances in a time of longer life expectancy». L’auteur met l’accent sur le fait que les liens au sein du couple qui vieillit ne reposent plus sur les alliances d’origine. Il faut alors les transformer, afin que l’évolution intervenue au fil du temps n’altère pas la vie psychoaffective du couple. Les membres d’un couple doivent être capables de renégocier leur manière d’être l’un avec l’autre et de reconnaître une nouvelle image d’eux-mêmes et de l’autre. Dans le cadre d’une thérapie, la capacité du couple à transformer ces liens peut permettre la mise en place d’un processus dynamique de restauration du fonctionnement psychique du couple, avec intégration des éléments de changement et de continuité. Sur la base de ces prémices, l’auteur propose un matériel clinique issu de thérapies auprès de couples âgés.
L’article d’Otto Kernberg est une nouvelle publication de «Relations amoureuses dans les années tardives», dans lequel l’auteur aborde le sujet sensible de l’amour entre personnes âgées et montre comment il est possible de recréer des situations d’intimité profonde en partageant le sentiment d’insécurité lié aux risques de l’âge (maladie, dépendance, limitation du temps restant à vivre). Kernberg observe que cet approfondissement de l’intimité permet une sexualité plus libre, capable d’intégrer des éléments pervers polymorphes infantiles. L’évolution de la constellation œdipienne au cours de la vie entière est ainsi posée, le développement des capacités affectives conduisant la femme vers la maturité sexuelle et l’homme vers une relation plus profonde. Pour l’auteur, l’amour passionnel serait également possible à cette étape ultime de la vie.
Dans «“L’ancêtre insuffisamment bon”: le maillon générationnel défaillant», Christiane Joubert analyse la crise du vieillissement et ses résonances familiales, notamment quant à la temporalité et à la nature du lien du couple âgé. Sa réflexion porte également sur la psychopathologie des personnes âgées, en particulier sur la démence sénile. Elle met en évidence les dysfonctionnements familiaux qui en découlent: les atteintes des liens au sein de la famille, notamment des liens fraternels, l’apparition d’une souffrance transgénérationnelle, avec altération du lien de filiation, conduisant à une perturbation généalogique et des effets sur la mémoire familiale. L’article est illustré par une situation clinique qui montre comment les dispositifs de prise en charge psychanalytique des familles au sein de l’institution gérontopsychiatrique visent, d’une part, à favoriser l’accès à la symbolisation et, d’autre part, à permettre un travail de séparation au sein de la famille et, par conséquent, à anticiper un travail de deuil.
L’article d’Alejandro Klein «Una aproximación desde el psicoanálisis para comprender las reconfiguraciones subjetivas actuales en los adultos mayores» a pour but de proposer des clés psychanalytiques pour mieux comprendre quels sont, de nos jours, les processus identitaires et les changements subjectifs chez les personnes âgées. L’hypothèse est qu’elles utilisent un dispositif que la psychanalyse a traditionnellement décrit comme se référant aux adolescents: la confrontation générationnelle. Il est suggéré que cette confrontation est redoublée, signifiée à nouveau, ce qui serait un élément décisif pour comprendre comment les nouvelles configurations de la subjectivité des adultes âgés se mettent en place. Pour l’auteur, la conception de cette «confrontation transgénérationnelle» marque une rupture décisive avec les modèles traditionnels de la vieillesse, car elle met en évidence la recherche d’opportunités nouvelles d’émancipation et de vie.
L’article d’Osvaldo Bodni «Vejez. Transmisión. Legados», fait état d’inquiétudes face à la baisse de considération dont les personnes âgées sont l’objet, à la fois dans la vie professionnelle, dans le discours familial et les prises de décision. Dans le monde du travail, l’expérience des personnes âgées est peu prise en compte, en raison de l’accélération technique et de l’obsolescence rapide des connaissances. De même, on assiste à une dévalorisation de leur rôle ancien de conteur. Tout cela fait émerger un sentiment d’inutilité, de solitude, voire des pensées dépressives. Dans ces conditions, la transmission des héritages culturels devient difficile, tandis que réapparaît une trame œdipienne chargée d’un poids mortifère. Une vignette clinique décrit une situation familiale sans hospitalisation où le rôle réparateur d’un accompagnant bien ajusté et supervisé est souligné.
«¿Vivir el duelo o estar de luto?» de Giacomo Di Marco propose une réflexion sur la mort en tant que phénomène inévitable et impénétrable autour duquel l’humanité tisse depuis des siècles une toile fragile de mythologies et de rituels qui sont autant de procédés magiques et de techniques destinés à masquer l’inéluctabilité de l’événement. L’auteur note que diverses ethnies dont les traditions sont différentes soutiennent l’idée que les morts naissent, vivent et renaissent sans cesse dans l’esprit des survivants. Selon les cultures, les morts sont imaginés identiques et préservés ou au contraire différents et transfigurés; dans tous les cas, ils survivent. En même temps, la survie des vivants est dialectiquement liée à la mort: elle dépend entièrement de l’acceptation (ou du refus) de la disparition du défunt, sujet qui suscite angoisse et mystère.
L’article de Federico Suárez «Una nueva vida en común para seguir siendo. Algunas líneas para reflexionar sobre el desarrollo de las viviendas de mayores» relate l’expérience de l’auteur en tant qu’observateur dans des groupes de discussion organisés dans le cadre d’un projet de recherche visant à connaître la situation actuelle et à réfléchir au développement possible des logements pour personnes âgées (VVMM) qui existent déjà dans la communauté autonome de Castille-La Manche, en Espagne. Sur la base de cette expérience, l’article propose quelques réflexions sur les particularités de ce recours et sur sa fonction d’indicateur de la qualité de vie des personnes âgées.
Ce numéro se clôt avec une note de lecture d’Irma Morosini sur le livre d’Osvaldo Bodni La delegación del poder en el envejecimiento humano. Teoría del legado y de la investidura del sucesor (Buenos Aires, Editorial Psicolibro ediciones, 2013.) Cet ouvrage convoque et met en lumière un sujet pertinent, qui n’a pas encore reçu l’attention voulue dans le champ psychanalytique, autour de la problématique de la métapsychologie du désir, du sens de l’héritage, de la succession et de la désignation du successeur éventuel. Sont abordées aussi les formes de transmission culturelle, des liens et des affects pour que soit préservée la mémoire et que se constitue l’histoire.